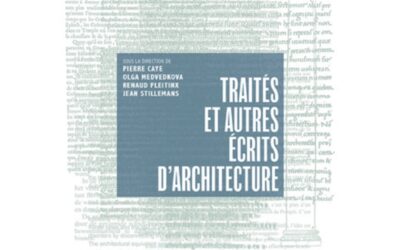Olga MEDVEDKOVA
Медведкова, Ольга Анатольевна
Equipe THETA – Directrice de recherche CNRS
Ancien membre du Centre Jean Pépin

Olga Medvedkova, née le 13 février 1963, est historienne de l’art et de l’architecture ; elle est directrice de recherche au CNRS-ENS (centre Jean Pépin), spécialiste dans le domaine de l’histoire d’architecture moderne, de la théorie et de l’édition architecturales à l’époque humaniste et classique, ainsi que de l’art et de la culture russe.
Etudes, diplomes et qualifications
- 2007 (23 février) : qualifiée pour le corps des professeurs des universités par la Commission Nationale Universitaire.
- 2006 (2 décembre) : habilitée à diriger les recherches, université de Paris-Sorbonne. Directeur : Claude Mignot. Composition du jury : Bruno Foucart, Sabine Frommel, Peter Fuhring, Marianne Grivel, Daniel Rabreau.
- 2000 (30 mars) : docteur en histoire et civilisation : thèse soutenue à l’EHESS, mention « très honorable avec félicitations à l’unanimité ». Directeur de thèse : Jacques Revel. Composition du jury : Bronizlaw Baczko, Georges Dulac, Antoine Schnapper, Véronique Schiltz, Michael Werner.
- 1992-2000 : doctorante à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
- 1985-1989 : doctorante en histoire de l’art, faculté d’Histoire, Université Lomonossov de Moscou.
- 1985 : diplômée d’histoire de l’art, Université Lomonossov de Moscou, « diplôme rouge » : mention « excellent ».
- 1980-1985 : étudiante à l’Université Lomonossov de Moscou. Faculté d’histoire, section d’histoire de l’art.
Enseignement, recherche et responsabilités
- 2021 : chargée de cours complémentaires à l’Université de la Sorbonne.
- 2020 : nommée co-directrice du groupe TETA au sein du centre Jean Pépin.
- 2019 : nommée membre de la commission « ARTS » du CNL.
- 2019 : chargée de cours complémentaires à l’Université de la Sorbonne.
- 2015 (1 octobre) : admise au concours 33/01 et nommée Directeur de recherche de 2e classe.
- 2014 (1 septembre) : mutation vers le centre Jean Pépin (UMR 8230).
- 2010-2012 : chargée de conférences complémentaires à l’EHESS.
- 2009 (automne) : titularisation en qualité de chargée de recherche de 1ère classe, titulaire.
- 2008 (1 octobre) : recrutée au CNRS en qualité de chargée de recherche (CR 1) ; affectée au centre André Chastel (UMR 8150).
- 2007-2008 (3 semestres) : chargée de cours à l’Université de Genève (programmes BA et MA).
- 2004-2006 (4 semestres) : chargée de cours complémentaires à l’EHESS.
- 2003-2007 : pensionnaire chercheur à l’Institut National d’Histoire de l’Art.
- Depuis 2001 : chercheur associé au CERCEC (EHESS).
- 1996-1998 : lectrice à l’Université de Paris-IV.
- 1995-2002 : professeur à l’école Ateliers de Sèvres, Paris.
- 1989-1992 : chercheur en histoire de l’art, Institut d’Histoire de l’art de Moscou.
Récompenses
- 2017 : prix Lequeux de l’Institut de France, sur proposition de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres.
- 2014 : Prix Révélation de la SDGL.
-
2013 : prix IntrAduction du festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau
-
2007 : prix Marianne Roland Michel.
Contact
Parution : Pierre Caye, Olga Medvedkova, Renaud Pleitinx, Jean Stillemans (dir.), Traités et autres écrits d’architecture, Bruxelles, Mardaga, 2021.
Pierre Caye, Olga Medvedkova, Renaud Pleitinx,...
Publications
Ouvrages
– 2019 : Léon Bakst : Лев Бакст, портрет художника в образе еврея. Опыт интеллектуальной биографии (Léon Bakst, le portrait de l’artiste en Juif; essai de biographie intellectuelle), en langue russe, НЛО, “Очерки визуальности”, 2019, (ISBN 978-54448-1154-2)
– 2014 : Léon Bakst. Serov et moi en Grèce (1923), traduit du russe et introduit par Olga Medvedkova. Paris, Triartis.
– 2014 : Kandinsky ou la Critique des critiques. Les écrits russes de Kandinsky (1889-1911) traduits, annotés et préfacés par Olga Medvedkova, Presses du réel
– 2010 : Les Icônes en Russie, Gallimard, (traduit en japonais) http://www.decouvertes-gallimard.fr…
Ouvrage traduit en langue japonaise.
Emission télé : Historiquement show, Le 12/03 à 19h35 et 22h35, présentée par Michel Field. http://www.histoire.fr/histoire/emi…
Emission radio : (RFI) animée par Galina Ackerman, le 15.04.2010. http://www.rfi.fr/acturu/articles/1… Interview avec Fabrice Midal, dans : La Vie, N° 3367, 11-17 mars 2010, p. 38-42.
CR : Bérénice Geoffroy-Schneiter, L’œil, n° 622, mars 2010.
CR : Pierre Gonneau, Revue des études slaves, 81/4, p. 587. http://www.etudes-slaves.paris-sorb…
– 2009 : Kandinsky, le peintre de l’invisible, Gallimard.
– 2007 : Jean-Baptiste-Alexandre Le Blond, architecte. De Paris à Saint-Pétersbourg, collection « République européenne des arts » dirigée par Marc Fumaroli et Antoine Compagnon, Paris, Alain Baudry éditeur. http://www.mariannerolandmichel.fr/prix.html#livres
CR : Anthony Cross, dans : The Russian Review : An American Quarterly Devoted to Russia Past and Present, t. 67, n° 2, april 2008, p. 337-338. http://www.jstor.org.gate3.inist.fr…
CR : James Cracraft, dans : Journal of the Society of Architectural Historians, v. 67, N° 2, june 2008, p. 285-286. http://www.jstor.org.gate3.inist.fr…
CR : Charlotte Guichard, dans : Annales, novembre-décembre 2008, p. 1431-1434.
CR : George E. Munro, dans : Slavic Review, t. 61, N° 1 p. 167 (Spring 2009). http://www.jstor.org.gate3.inist.fr… Krzysztof Pomian, dans : Cahiers du monde Russe, 48/4, p. 682-683. http://monderusse.revues.org/6061
Emission radio, dans : Métropolitains de François Chaslin, le 1 octobre 2008. http://www.franceculture.fr/emission-jean-baptiste-alexandre-le-blond-architecte-evocation-de-pierre-sansot-2008-10-01.html
– 2006 : Architectures imprimées. La circulation des modèles d’architecture dans l’Europe du xviie et du xviiie siècles, mémoire d’habilitation, université Paris-IV
– 2000 : L’Architecture française en Russie au xviiie siècle, thèse de doctorat soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales, t. 1-2, Paris.
– 1996 : Histoire de Saint-Pétersbourg, Librairie Arthème Fayard, en collaboration avec Wladimir Berelowitch, traduit en bulgare)
– 1991 : L’Art russe, Éditions Citadelles et Mazenod, Paris , en collaboration avec Nina Dmitrieva et Mikhaïl Allenov, Chapitre : « L’art russe occidentalisé et l’architecture du XVIII
Ouvrages collectifs ou co-dirigés
– Olga Medvedkova, Philippe Malgouyres (dir.), Aimer l’art russe : 30 tableaux russes du XIXe siècle, vus autrement, Paris, Mare et Martin, à paraître en 2021.
– Pierre Caye, Olga Medvedkova, Renaud Pleitinx, Jean Stillemans (dir.), Traités et autres écrits d’architecture, Bruxelles, Mardaga, 2021.
– Olga Medvedkova (dir.), Les Européens: ces architectes qui ont bâti l’Europe, Peter Lang, 2017.
– Olga Medvedkova (dir.), Pierre le Grand et ses livres. Les arts et les sciences de l’Europe dans la bibliothèque du Tsar, Paris, Respublica Literaria, Alain Baudry et Cie, 2016.
– Pierre le Grand et ses images de Rome, Cahiers du monde russe, éditions de l’EHESS, 51/1, 2011.
– Bibliothèque de Pierre le Grand, Cahiers du monde russe, éditions de l’EHESS, 47/3, juillet-septembre 2006.
– Olga Medvedkova, Émilie d’Orgeix (dir.), Architectures de guerre et de paix : Du modèle militaire antique à l’architecture civile moderne, sous la direction, Mardaga, Bruxelles, 2013.
– L’Invention de la Sainte Russie : L’Idée, les Mots, les Images, éditions de l’EHESS, numéro spécial des Cahiers du monde russe, 53/ 2-3 sous la direction de Wladimir Berelowitch et d’Olga Medvedkova, 2013.)
– Olga Medvedkova (dir.), Bibliothèques d’architecture / Architectural libraries, Paris, INHA-Alain Baudry éditeur, 2009.
Numéros spéciaux de revues
1. Bibliothèque de Pierre le Grand : Cahiers du Monde Russe, éditions de l’EHESS, 47/3, juillet-septembre 2006, p. 467-502.
http://monderusse.revues.org/index4…
2. Pierre le Grand et ses images de Rome, Cahiers du Monde Russe, éditions de l’EHESS, 51/1, 2011.
Emission radio : vendredi, le 28 octobre 2011, La Fabrique de l’histoire (France Culture de 9h05 à 10h) parle des Cahiers du Monde russe, plus précisément du numéro 51/1 “Pierre le Grand et ses images de Rome”.
http://www.franceculture.fr/oeuvre-cahiers-du-monde-russe-n%C2%B0-51-1-pierre-le-grand-et-ses-images-de-rome-de-collectif
3. Nikolaï Prorokov (1945-1972), et les poètes russes du Dégel co-direction d’un numéro spécial de la revue Les Hommes sans épaules, n° 44, 2017.
http://www.leshommessansepaules.com… [archive] CR/ Carole MESROBIAN (Revue des revues www.recoursaupoeme.fr )
CR : Décharge 176 http://www.dechargelarevue.com/Les-…
CR : Jean-Pierre LESIEUR ( Comme en poésie n°72, décembre 2017)
CR : Rémi BOYER (incoherism.wordpress.com, novembre 2017)
https://incoherism.wordpress.com/20…
CR : Georges CATHALO (Lectures flash 2018, revue-texture.fr, janvier 2018)
Ouvrages de vulgarisation
1. Kandinsky, le peintre de l’invisible, Gallimard, Découvertes, 2009.
http://www.decouvertes-gallimard.fr… Interview : RFI, 8 avril 2009.
2. Au-dessus de Saint-Pétersbourg. Dialogue au royaume des morts entre le tsar Pierre le Grand et son architecte Jean-Baptiste Alexandre Le Blond, pièce en deux tableaux, Paris, Triartis, 2013.
3. Les icônes en Russie, Gallimard, Découvertes, 2010. http://www.decouvertes-gallimard.fr/Decouvertes/Control.go?action=fic_ouvrage&prod_code=A43652 Ouvrage traduit en langue japonaise.
Emission télé : Historiquement show, Le 12/03 à 19h35 et 22h35, présentée par Michel Field.
Emission radio : (RFI) animée par Galina Ackerman, le 15.04.2010. http://www.rfi.fr/acturu/articles/124/article_6020.asp
Interview avec Fabrice Midal, dans : La Vie, N° 3367, 11-17 mars 2010, p. 38-42.
Comptes rendus :
Bérénice Geoffroy-Schneiter, dans L’œil, n° 622, mars 2010 Pierre Gonneau, dans la Revue des études slaves, res. 81, fasc. 4, p. 587. http://www.etudes-slaves.paris-sorbonne.fr/spip.php?article734
4. Mémoire de l’architecte V. nouvelle, Paris, Triartis, 2015.
CR : Archiscopie, juillet 2015, p. 114-115.
Traductions et commentaires
– Kandinsky ou la critique des critiques. Les écrits russes de Kandinsky (1889-1911) traduits, annotés et préfacés par Olga Medvedkova, Presses du réel, 2014. http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=2025 CR : Flaurette Gautier (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Histara, les comptes rendus (histoire de l’art, histoire des représentations et archéologie) : http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2147 ; Axelle Fariat, Critique d’art [En ligne], Toutes les notes de lecture en ligne, mis en ligne le 15 novembre 2015, consulté le 12 août 2015. URL : http://critiquedart.revues.org/15345 ; John E. Bowlt, dans The Russian Review, 73/4 (october 2014), p. 627-628 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/… ; Emission France culture : 21.04.2014 – Pas la peine de crier Le triangle (1/5) : Kandinsky et le triangle : 60 mn http://www.franceculture.fr/oeuvre-…
– Léon Bakst. Serov et moi en Grèce (1923), traduit du russe et introduit par Olga Medvedkova. Préface de Véronique Schiltz, membre de l’Institut. Paris, Triartis, 2014. L’ouvrage a obtenu le prix de la traduction du Salon du livre et de la revue d’art du festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau.
– Alexandre Pouchkine. Mozart et Salieri, traduction et postface d’Olga Medvedkova, Paris, Alain Baudry et Cie, 2014.
Articles dans revues et actes de colloques, chapitres de livres : en langue russe (15), en langues française, italienne et anglaise (66)
a. Europe-Russie : circulation des modèles
– « Tsaritsynskaia psevdo-gotika Bazhenova : opyt interpretatsii » (L’architecture néo-gothique de Bajenov à Tsaritsyno : essai d’interprétation), Voprosy iskusstvoznaniia, 4, 1993, Moscou, p. 56-70.
– « ‘Solomonov khram — dom premudrosti’ : k istorii neosushchestvlennogo proekta khrama Khrista Spasitelia arkhitektora A.L.Vitberga » (Le temple de Salomon, maison de la sagesse : à propos du projet non réalisé d’église du Saint-Sauveur par l’architecte Vitberg), Revue des Etudes slaves, Paris, LXV, 3, 1993, p. 459-468. https://archive.org/details/LeTempleDeSalomon
– « Kolokol’nia » (Le clocher), Revue des Etudes slaves, Paris, LXVI, 2 (1994), p. 285-296. https://archive.org/details/LeClocher
– « Tvorchestvo Voronikhina i romanticheskie tendentsii v nachale XIX veka » (L’œuvre de Voronikhine et les tendances romantiques au début du XIXe siècle), Arkhitektura mira, 5, Moscou, 1996, p. 52-59.
– « Royauté et féminité : l’invention de l’image de l’impératrice en Russie au XVIIIe siècle », Modernités russes, 4, La femme dans la modernité, Lyon, 2002, p. 21-36. https://archive.org/details/RoyautEtFfminiti
– « Le comte de Caylus et la peinture d’histoire en Russie », Revue de l’art, 136, 2002, 2, p. 25-36.
– « ‘Dà letizia… ed… altre fantasie’ : il progetto russo di Sebastiano Cipriani », Pinakoteka, n°16/17, 2003, p. 126-135.
– « Diderot face à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg : le paradoxe de l’écorché », La France et les Français à Saint-Pétersbourg. XVIII-XX siècles, actes du colloque, Saint-Pétersbourg, 2005, p. 79-94. (également en traduction russe : Отношения между Россией и Францией в европейском контексте (в XVIII-XX вв.). История науки и международные связи, Moscou, INION, RAN) https://archive.org/stream/LesFrancaisASaintPetersbourg/%20Les%20français%20à%20Saint-Petersbourg_djvu.txt
– « Wille et les Russes », actes du colloque international Johann Georg Wille (1715-1808) et son milieu. Un réseau européen de l’art au XVIIIe siècle, École du Louvre, Rencontres de l’Ecole du Louvre, 2009, 191-203.
b. Europe-Russie : transferts architecturaux. Les architectes émigrés
– « Catherine II et l’architecture ‘à la française’ : le cas de Vallin de la Mothe », dans Catherine II et l’Europe, actes du colloque, Paris, décembre 1996, Paris, Institut d’études slaves, 1997, p. 188-199.
– « Avant la Russie : Vallin de la Mothe et le concours pour la place Louis XV », Pinakoteka, 13-14, 2002, p. 64-71.
– « Le plan général de Saint-Pétersbourg de Le Blond : vision utopique ou projet moderne ? », Les Français à Saint-Pétersbourg, catalogue de l’exposition, Saint-Pétersbourg, 2003, p. 26-40.
– « Les architectes et les artistes français à Saint-Pétersbourg : présences directes et indirectes », Les Français à Saint-Pétersbourg, catalogue de l’exposition, Saint-Pétersbourg, 2003, p. 110-114.
c. Europe-Russie : la circulation des livres et les bibliothèques d’architecture
– « La première édition russe de Palladio par Nijolai L’vov et le problème du ‘vrai goût palladien’ », Cahiers du Monde russe, 43/1, janvier-mars 2002, p. 35-56.
– « La prima edizione di Palladio in Russia », Dal Mitto al progetto, La cultura architettonica dei maestri italiani e ticinesi nella Russia neoclassica, catalogue de l’exposition, Archivio del Moderno, Academia di Architectura, Mendrisio, Museo Cantonale d’Arte, Lugano, 2003, p. 291-315.
– « Les sources de l’anticomania architecturale en Russie sous Catherine II : France, Allemagne, Italie, Angleterre », Russie, France, Allemagne, Italie. Transferts quadrangulaires du néoclassicisme aux avant-gardes, textes rassemblés par Michel Espagne, Du Lérot éditeur, Tusson, Charente, 2005, p. 51-70. https://archive.org/details/Anticom…
– « Bibliothèques d’architecture », Les Nouvelles de l’INHA, 2005, p. 2-4.
– « La bibliothèque d’architecture de Pierre le Grand : entre Curiosité et Passion », Cahiers du Monde Russe, EHESS, 47/3, juillet-septembre 2006, p. 467-502. http://www.cairn.info/revue-cahiers… http://www.jstor.org.gate3.inist.fr…
– « La Maison de Glace ou architecture comme science expérimentale », actes de la journée d’étude internationale La science et l’enseignement de l’architecture dans les académies de l’Europe moderne (Oxford, mars 2006), Voltaire Foundation, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century (SVEC), 2008, p. 29-44. http://cat.inist.fr/?aModele=affich…
– « Collezionare l’architettura. Charles Cameron, Caterina II e le terme dei Romani », Piervaleriano Angelini, Nicola Navone, Letizia Tedeschi ed., La cultura architettonica italiana in Russia da Caterine II a Alessandro I, Medrisio Academy Press, Mendrisio, 2008, p. 69-84.
– « La référence romaine dans la bibliothèque de Pierre le Grand », Cahiers du Monde Russe, 51/1, 2011, p. 67-70. http://monderusse.revues.org/7276 http://www.cairn.info/resume.php?ID…
– « L’Idea pour Saint-Pétersbourg : Pierre le Grand et Vincenzo Scamozzi. », Cahiers du Monde Russe, 51/1, 2011, p. 135-166. http://monderusse.revues.org/7284 http://www.cairn.info/resume.php?ID…
– « Suvalov à Rome (1765-1774) : histoire d’une dédicace », Cahiers du Monde Russe, 52/1, janvier-mars 2011, p. 45-73. http://www.cairn.info/resume.php?ID…
– « Neufforge « lu » par les Russes », Le Siècle des Lumières III, L’art occidental en Russie du XVIIIe siècle, Textes, collections, maîtres, Moscou, Nauka, 2011, p. 132-152. https://archive.org/details/Neuffor…
– « Une aventure de traduction à la fin du XVIIIe siècle : la première édition de Vitruve en Russie », « Claude Perrault. Les dix livres d’architecture de Vitruve. Frontispice ; Sebastien Leclerc. Les proportions de l’homme », Sabine Frommel, Eckhard Leuschner ed., Architektur- und Ornamentgraphik der Frühen Neuzeit : Migrationsprozesse in Europa. Gravures d’architecture et d’ornement au début de l’époque moderne : processus de migration en Europe, Campisano Editore, Roma, collection : Hautes Etudes : Histoire de l’art/Storia del arte, 2014, p. 88-89, 100-101, p. 345-356. ISBN : 978-88-98229-22-2
– CR : Oxana Makheeva-Barabanova, Ledoux, maître à penser des architectes russes. Du classicisme au postmodernisme, XVIIIe-XXe siècle, éditions du patrimoine, Paris, 2010, Slavica Occitania, 38, Le littéraire et le visuel dans la culture russe des XXe et XXIe siècles, Catherine GÉRY, Hélène MÉLAT ed., 2014, p. 253-256. http://w3.slavica-occitania.univ-tl… ISBN : 978-2-9538558-7-6
d. L’édition et la circulation des livres d’architecture en Europe : XVIe – XVIIIe siècle
– « Robert Morris et les sciences », compte rendu, Bulletin Monumental, 163-III, 2005 p. 267.
– « François Cointeraux : architecture en pisé et relations franco-américaines », compte-rendu, Bulletin Monumental, V, 2006, p.213-214.
– « L’édition des livres d’architectures en français dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », Claude Nicolas Ledoux et le livre d’architecture en français : Etienne-Louis Boullée, l’utopie et la poésie de l’art, textes réunis par Daniel Rabreau et Dominique Massounie, Paris : Monum, Éditions du Patrimoine, 2006, p. 72-85. https://archive.org/details/EditionDesLivresDarchitectureEnFrancaisDansLAngleterreDuXVIII
– « Rubens et les Palazzi di Genova », Perspective, 2007-2.
– « Un Abrégé moderne ou Vitruve selon la méthode », La construction savante. Les Avatars de la littérature technique, textes réunis par Jean-Philippe Garric, Valérie Nègre et Alice Thomine-Berrada, CNAM-INHA, Paris, Picard, 2008, p. 43-53. https://archive.org/details/VitruveSelonLaMthode
– « Le comte de Caylus entre les antiquaires et les amateurs », Réseaux intellectuels et sociabilité culturelle en Europe de 1760 à la Restauration, actes du colloque international, Université de Genève (décembre 2003), Genève, Droz, 2009, p. 123-147. http://books.google.fr/books?id=XVG-7uEgHCkC&pg=PA123&dq=Olga+Medvedkova&hl=fr&sa=X&ei=W7_JUMaaJImWhQfau4DgBw&ved=0CEcQ6AEwBQ#v=onepage&q=Olga%20Medvedkova&f=false
– « Introduction » et « Charles Cameron et ses livres », Bibliothèques d’architecture : architectural libraries, ouvrage collectif sous la direction d’Olga Medvedkova, Paris, INHA-Alain Baudry éditeur, 2009, p. 9-20 ; 211-240.
– « Les recueils de peintures antiques romaines : à propos des stratégies éditoriales dans l’Europe du XVIIIe siècle », actes du colloque international : A l’Origine du Livre d’Art Les recueils d’estampes comme entreprise éditoriale en Europe (XVIe-XVIIIe siècles), textes réunis par Cordélia Hattori, Estelle Leutrat, Véronique Meyer, Milano, Silvana Editoriale, 2010, p. 193-206.
– CR : Jacques Guillerme, L’art du projet. Histoire, technique et architecture (Mardaga, 2008), Annales. Histoire, Sciences sociales, 65e année, N° 6, novembre-décembre 2010, p. 1512-1513. https://archive.org/details/JacquesGuillerme
– Olga Medvedkova, Emilie d’Orgeix, « Architectures pour la guerre et pour la paix : l’humanisme civil et militaire dans l’Europe du XVIe au XVIIIe siècle », Les Nouvelles de l’INHA, N° 39, avril, 2011, p. 9-10.
– « La colonne comme trophée dans l’Histoire naturelle de Pline », Architectures de guerre et de paix : du modèle militaire antique à l’architecture civile moderne, ouvrage collectif sous la direction d’Olga Medvedkova et d’Emilie d’Orgeix, Mardaga, Bruxelles, 2013, p. 33-45.
– Olga Medvedkova, Émilie d’Orgeix, « L’architecture militaire et civile : les jeux et les enjeux disciplinaires », Architectures de guerre et de paix : du modèle militaire antique à l’architecture civile moderne, ouvrage collectif sous la direction d’Olga Medvedkova et d’Emilie d’Orgeix, Mardaga, Bruxelles, 2013, p. 5-10.
– « Adolphe Lance », Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, INHA,
– « Alexandre de Laborde », Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale, INHA,
– « Architettura di… » : les noms des architectes dans les publications sur l’architecture romaine moderne, Charlotte Guichard éd., De l’authenticité. Une histoire des valeurs de l’art (16e-20e siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 45-62. ISBN : 978-2-85944-800-4
– « Paestum ou la Grèce retrouvée », « L’architecture antique ‘in folio’ », D’après l’antique, Textes et documents pour la classe N°1087, SCEREN-SNDP, p. 30-33. ISSN : 0395-6601
– « Caylus versus Pline : le théâtre de Scribonius Curion », Scholion : Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, 8/2014, p. 120-143.
– Olga Medvedkova, Robert Carvais, « Les Edifices antiques » :
– « Richard Pococke, or the invention of Jerusalem for Tourists”, Bianca Kühnel, Galit Noga-Banai, Hanna Vorholt ed., Visual Constructs of Jerusalem, B. Kühnel, G. Noga-Banai, H. Vorholt, eds., Brepols Publishers, 2015, p. 429-439, ISBN : 978-2-503-55104-3. http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503551043-1
– « In the beginning was the Fire : around Vitruvius (II, 1-2)”, Marco Folin, Monica Preti éd., The Wounded City. The Representation of Urban Disasters in European Art, Ashgate, Surrey, 2015, p. 75-99.
– « Scamozzi en français : histoire d’un échec », Valérie Nègre, Robert Carvais éd., Traduire l’architecture, Éditions Picard, Paris, p. 133-144, à paraître.
– CR : Bâtir au féminin ? Traditions et stratégies en Europe et dans l’Empire ottoman, sous la direction de Sabine Frommel et Juliette Dumas, avec la collaboration de Raphaël Tassin, Picard, Paris, 2013, ArtItalies, à paraître.
e. Europe-Russie : transferts historiographiques
– « L’École d’histoire de l’art à l’Université de Moscou », dans Où va l’histoire de l’art contemporain. Objets, territoires, méthodes, actes du colloque international, février 1995, Paris, L’image et l’ENSBA, 1997, p. 49-56.
– « Les revues d’art russes face à la nouvelle transparence », Critique, n° 644-645, janvier-février 2001, p. 107-119. http://library.getty.edu:7108/vwebv…
– « Les paradoxes de la modernité passéiste dans le livre de Georgii Lukomskii, Saint-Pétersbourg moderne », Les lieux de la modernité russe, Université de Lyon-III, sous la direction de Jean-Claude Lannes, 2001, p. 113-124. https://archive.org/details/Modernitesrusses
– « ‘Scientifiques’ ou ‘intellectuels’ ? Louis Réau et la création de l’Institut français de Saint-Pétersbourg », Cahiers du Monde russe, 43/2-3, avril-septembre 2002, p. 411-422.
– « La Russie face à l’Europe artistique : Vladimir Stassov et l’Exposition Universelle de 1862 », Transitions, Genève, 2006, p. 55-66.
– « Aux origines de Saint-Pétersbourg », « Entre l’Orient et l’Occident : à la recherche de l’art médiéval en Russie », L’Archéothema : Revue d’archéologie et d’histoire, hors-série 1, mars 2010, Sainte Russie : de la Kiev de Saint Vladimir à la Pétersbourg de Pierre le Grand (Xe-XVIIIe siècle), p. 56-65. http://www.archeothema.com/numero/sainte-russie.htm
– « Entre l’Orient et l’Occident : l’invention de l’art médiéval en Russie », Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, comptes rendues des cours et conférences 2010-2011, EHESS, 2012, p. 633-635.
– Wladimir Berelowitch, Olga Medvedkova, « Introduction », L’invention de la Sainte Russie : l’idée, les mots, les images, éditions de l’EHESS, numéro spécial des Cahiers du Monde Russe, 53/ 2-3 sous la direction de Wladimir Berelowitch et d’Olga Medvedkova, 2013, p. 295-300.
– « Fedor Buslaev (1818-1897) à l’origine de l’histoire de l’art médiéval russe », L’invention de la Sainte Russie : l’idée, les mots, les images, éditions de l’EHESS, numéro spécial des Cahiers du Monde Russe, 53/ 2-3 sous la direction de Wladimir Berelowitch et d’Olga Medvedkova, 2013, p. 385-404. https://archive.org/details/FedorBuslaev
– CR : Ivan Foletti, Da Bisanzio alla Santa Russia. Nikodim Kondakov (1844-1925) e la nascita della storia dell’arte in Russie, Roma, Viella, 2011 ; Iconographie de la Mère de Dieu, Vol. III, par N.P. Kondakov. Introduction et édition d’Ivan Foletti, Rome, Lipa, 2011, Cahiers du Monde Russe, 2013, 53/4, http://monderusse.revues.org/7802.
– « Entre l’Orient et l’Occident : l’invention de l’art médiéval en Russie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. De l’Apocalypse russe à l’Iconographie de la Vierge », Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, comptes rendues des cours et conférences 2011-2012, EHESS, 2013, p. 568-569.
f. L’art russe
– Stilisticheskie transformatsii v russkom portrete kontsa XVIII veka » (Les transformations stylistiques du portrait russe à la fin du XVIIIe siècle), Aktual’nye problemy russkogo iskusstva, Moscou, 1990, p. 37-49.
– « Russkoe iskusstvo pavlovskogo vremeni : norma i paradoks » (L’art russe à l’époque de Paul I : la norme et le paradoxe), Problemy russkoi kul’tury XVIII veka, Moscou, 1991, p. 60-72.
– « Predromanticheskie tendentsii v russkom iskusstve rubezha XVIII-XIX vekov. Mikhailovskii zamok » (Les tendances préromantiques dans l’art russe à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle : le château Saint-Michel), Russkii klassitsizm vtoroi poloviny XVIII – nachala XIX veka, Moscou, 1994, p. 166-174.
– « Marianne von Werefkin (1860-1938) », A. Sarabjanov, V. Rakitine éd., Encyclopédie de l’avant-garde russe, I volume, Moscou, Avant-garde russe, 2013, p. 151-152.
– « Alexander von Salzmann (1874-1934) », A. Sarabjanov, V. Rakitine éd., Encyclopédie de l’avant-garde russe, I volume, Moscou, Avant-garde russe, 2013, p. 349-350.
– « Parizhanin ponevole » (Un Parisien malgré lui : à propos de la dernière période de Wassily Kandinsky ) Riviera russe, n° 4, hiver 2013, p. 44-49 : 99910-8-F.
– « Obschestvo Falanga » (La Société Phalanx), A. Sarabjanov, V. Rakitine éd., Encyclopédie de l’avant-garde russe, II volume, Moscou, Avant-garde russe, 2014, p. 245-248.
– « Novoe Mjunhenskoe hudožestvennoe obščestvo » ( Neue Künstler-Vereinigung München), A. Sarabjanov, V. Rakitine éd., Encyclopédie de l’avant-garde russe, III volume, 2e livre, Moscou, Avant-garde russe, 2014, p. 248-250.
– « Sinij vsadnik, almanakh » (Le Cavalier bleu, almanach), A. Sarabjanov, V. Rakitine éd., Encyclopédie de l’avant-garde russe, III volume, 2e livre, Moscou, Avant-garde russe, 2014, p. 251-252.
– « Sinij vsadnik, vystavki » (Le Cavalier bleu, expositions), A. Sarabjanov, V. Rakitine éd., Encyclopédie de l’avant-garde russe, III volume, 2e livre, Moscou, Avant-garde russe, 2014, p. 252-254.
– « ‘Les Russes ont leur Parnasse…’ : Pouchkine et les artistes russes émigrés dans la collection de René Guerra », Les peintres russes émigrés 1920-1970, Images de Pouchkine. Portraits d’exil, catalogue de l’exposition de la collection René Guerra, 1999, p. 25-35.
– Série d’articles sur l’art et l’architecture russes (« L’art russe du XVIIIe et du XIXe siècle », « Cameron », « Dobouzhinski », « Fabergé », « Le Blond », « Le Prince », « Peterhof », « Rinaldi », « Tsarskoïe Selo », « Vallin de la Mothe », « L’anneau d’or » etc.) pour l’Encyclopaedia Universalis, 1997-2000. Reproduit partiellement dans : Dictionnaire des architectes, Encyclopedia Universalis, Albin Michel, 1999.
– Wladimir Berelowitch, Olga Medvedkova, « Pierre le Grand », Magazine Littéraire, 2003, n° 420, p. 30-32.
– « Kandinsky en 1901 : la critique des critiques »,Centre d’Histoire de Sciences Po. Art et Société. Lettre du Séminaire 25 : Le pouvoir des artistes. http://www.artsetsocietes.org/f/f-olga.html
– « Illustrer Pouchkine ? Notes en marge », Pouchkine illustré, sous la direction de Julien Collonges et Dmitry Kudryashov, Somogy Editions d’art, p. 201-207.
– « Tout l’art russe en deux œuvres », Dada, N° 155, avril 2010, p. 24-25
– « Du Jugement dernier à la Vierge de Vladimir. Aux origines du culte des images en Russie », Le Point Références, janvier 2010 – février 2011, p. 24-25.
– « Sous le voile protecteur : les apparitions de la Vierge entre Constantinople et Moscou », Regards sur Marie, sous la direction de Gilles Granjean et Philippe Malgouyres, Le Puy-en-Velay, Hôtel-Dieu, Lyon, Fage éditions, 2011, p. 12-28. L’ouvrage a reçu le prix Grellet de la Deyte pour 2011 de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont.
– « Kandinsky, un dégénéré à Paris », L’art en guerre. France. 1938-1947, Musée d’art moderne de la ville de Paris, sous la direction de Laurence Bertrand Dorléac et Jacqueline Munck, Paris-Musées, 2013, p. 369-370.
CR : Ziadé, Raphaëlle : Les icônes du Petit Palais. 71 p., 15,1 cm × 20,9 cm × 0,7 cm, ISBN 978-2-7596-0218-6, (Paris Musées, Paris 2013), dans Histara : http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2146
Colloques, journées d’étude, enseignement
– 1995 :
1. Où va l’histoire de l’art contemporain. Objets, territoires, méthodes, colloque international, Paris, ENSBA, février 1995.
– 1996 :
1. Catherine II et l’Europe, colloque international, Paris, Université de Sorbonne, décembre 1996.
– 2001 :
1. « Les modèles français dans l’architecture de Saint-Pétersbourg au XVIII siècle », conférence au Louvre, janvier 2001.
– 2002 :
1. Autant de modèles de bon goût… Jean-François de Neufforge et l’architecture du XVIIIe siècle en Europe, colloque international, Katolieke Universiteit Leuven, octobre 2002.
– 2003 :
1. L’influence française en Russie au XVIIIe siècle, colloque international, Paris, Sorbonne, mars 2003.
2. Réseaux intellectuels et sociabilité culturelle en Europe de 1760 à la Restauration, colloque international, Université de Genève, décembre 2003.
3. « Le comte de Caylus et l’architecture », conférence au Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Paris, octobre 2003.
4. La France et les Français à Saint-Pétersbourg. XVIII-XX siècles, colloque international, Saint-Pétersbourg, 2003.
– 2004 :
1. Livres d’architecture, journée d’étude, INHA-Centre Allemand d’Histoire de l’Art, mars 2004 (« Le livre d’architecture entre l’iconologie et l’histoire culturelle »).
2. Livres d’architecture, journée d’étude, INHA-Ensba, mai 2004 (« Qu’est-ce qu’un livre d’architecture ? »).
3. Espace culturel et l’Europe à l’époque de Catherine II : livres, objets d’art, pratiques culturelles, Moscou, septembre 2004 (« Collectionner l’architecture »).
4. Claude-Nicolas Ledoux et le livre d’architecture en français. Du « Vitruve » de Claude Perrault à l’Architecture de 1804, colloque international, Université de Paris I – INHA, décembre 2004.
– 2005 :
1. Russie, France, Allemagne, Italie. Transferts quadrangulaires du néoclassicisme aux avant-gardes, colloque international, Paris, ENS, 2005.
2. Les Avatars de la littérature technique, colloque international, CNAM-INHA, mars 2005.
3. Les livres d’architectures dans la collection Jacques Doucet, Table ronde, INHA, mai 2005.
4. Les livres d’architecture antique dans l’Europe du XVII et du XVIIIe siècle, dans le séminaire de François Lissarrague, EHESS, septembre 2005.
5. Roma e la creazione di un patrimonio culturale europeo nella prima età moderna : l’impatto degli agenti e dei corrispondenti di arte e architettura, colloque international, Roma, Bibliotheca Hertziana, octobre 2005.
6. Bibliothèques d’architecture : question de sources et de méthodes, journées d’études internationales, INHA-AFHA, janvier 2005.
7. Antiquité et orientalisme à travers les éditions illustrées au XVIIe et au XVIIIe siècle, séminaires de François Pouillon et François Lissarrague, 2 séances, EHESS, janvier-février 2005.
– 2006 :
1. La science et l’enseignement de l’architecture dans les académies de l’Europe moderne, Oxford, mars 2006.
2. L’appartement monarchique et princier en France et dans les pays germaniques, 1650-1750, colloque international, 8-10 juin 2006, Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Paris (« Comment les modèles français et allemands s’appliquent à Saint-Pétersbourg : les appartements de Pierre le Grand »).
3. Les trois premières expositions universelles et le débat critique franco-anglais , conférence, Ecole du Louvre – Université de Paris X, 2006.
4. Les orientalismes en architecture à l’épreuve des savoirs. Europe et monde extra-européen, XIXe et XXe siècles, colloque international, Paris, 4-5 mai 2006, INHA (« Les ‘architectures orientales’ à travers les ouvrages illustrés dans l’Europe du XVIIIe siècle : aux origines d’un paradigme »).
5. A l’Origine du Livre d’Art. Les recueils d’estampes comme entreprise éditoriale en Europe : Graver d’après les peintures, les dessins et les sculptures du XVIe au XVIIIe siècle, Colloque international 20-21 octobre 2006, Association des historiens de l’art italien (AHAI), Fondation Custodia, Institut de France.
– 2007 :
1. Johann Georg Wille (1715-1808) et son milieu, Colloque international École du Louvre, UMR “Pays germaniques (transferts culturels)”, CNRS/École Normale supérieure, janvier 2007.
2. Percier et Fontaine : Architecture, décoration, théorie, Journée d’études (EPHE-INHA), 19-20 mars 2007.
– 2008 :
1. L’Europe en Russie : Quelques figures d’un transfert culturel, de la bibliothèque de Pierre le Grand aux sciences humaines de l’Âge d’argent, Colloque international, 7-8 novembre 2008, Ecole normale supérieure. (« Pierre le Grand et ses images de Rome ».)
2. La Nation, enjeu de l’histoire de l’art en Europe, 1900-1950, Journée d’étude, INHA, 18 novembre 2008, « L’invention d’une école russe : Richard Muther, Alexandre Benois, Christian Brinton ».
3. Jules Hardouin-Mansart, Colloque international / 11 décembre (Cité de l’architecture et du patrimoine) et 12 et 13 décembre 2008 (Galerie basse du château de Versailles) (« Mansart ‘en images’ : les stratégies de la représentation »). http://chateauversailles-recherche.fr/IMG/pdf/Carton-Mansart.pdf
– 2009 :
1. Imiter ce qui a disparu : Les artistes modernes face aux lacunes de l’héritage antique : Colloque international, Académie de France à Rome, 5-6 mars 2009, séminaire organisé par Daniela Gallo et Neville Rowley, Intervention : « Caylus versus Caylus : entre le refus et l’éloge de l’écrit ».
2. Arts et Sociétés : Séminaire dirigé par Laurence Bertrand Dorléac, séance « Le valeur de l’art », 14 mai 2009, intervention : « Kandinsky en 1901 : la critique des critiques ».
3. Patrons, Collectors, Merchants and their Spaces : Séminaire Ph.D in “Theories and History of Arts” with Duke University, 16 mai 2009, intervention « The Jacques Doucet’s Library of Art ».
4. Petites leçons d’histoire de l’art : Journées Européennes du Patrimoine 2009. INHA, galerie Colbert, 19 septembre 2009 : « L’affiche de la première exposition de Phalanx par Wassily Kandinsky (1901).
5. Bibliographie du livre d’architecture français. Définitions et limites. Traduire l’architecture : Journées d’études organisées par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), le Centre d’Histoire des Techniques et de l’Environnement (CDHTE, CNAM) et la Bibliothèque du CNAM. 12 et 13 novembre 2009. Communication : « Un fonds sur mesure : les livres d’architecture et d’archéologie dans la bibliothèque de Jacques Doucet ».
– 2010 :
1. Bibliothèques d’architecture : intervention de 3 heures en maîtrise à l’Université de Toulouse-Mirail. 22 janvier 2010.
2. L’invention de la Sainte Russie. Auditorium du musée du Louvre, (co-organisation avec Wladimir Berelowitch, François-René Martin, Monica Preti-Hamard et intervention : « ‘Le visage sombre de l’icône’ : La reproduction des icônes dans les éditions russes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle »). 26 et 27 mars 2010
3. Les icônes en Russie : entre l’Eglise et le Musée, conférence, le 21 avril 2010, Université de Genève.
4. Desgodets : Journée d ‘études, INHA (intervention : « La fortune des Edifices antiques de Rome (1682) dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles ») : 31 mai 2010, INHA.
5. Originalité, authenticité, authentification des œuvres d’art, Journée d’études organisée à l’université Lille-3 dans le cadre du programme ANR « Marchés de l’art en Europe, 1500-1800 » (coordination : Charlotte Guichard, chargée de recherches, CNRS IRHIS) ; 14 Juin 2010. Intervention : “’Architettura di…’ : la mention des auteurs dans les publications sur l’architecture romaine des éditeurs de’Rossi (XVIIe-début du XVIIIe ss.)”.
6. De l’utilité des bibliothèques pour les arts : Table ronde (organisation et participation) : Organisée par Françoise Levaillant et Olga Medvedkova (CNRS), avec la collaboration de Catherine Limousin et de Clélia Simon, dans le cadre du Centre André Chastel – Laboratoire de recherche en histoire de l’art (UMR 8150, université Paris Sorbonne-Paris IV/CNRS/ministère de la Culture et de la Communication) : Lundi 5 juillet 2010
7. Le Jugement dernier entre Occident et Orient : Cycle de conférences d’histoire de l’art au Louvre. « Ô Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? « Le Jugement dernier » d’André Roublev », 18 octobre 2010.
8. Visual Constructs of Jerusalem : International Conference. The Hebrew University of Jerusalem, The Edmond J. Safra Campus, Givat Ram Institute for Advanced Studies Conference Hall (Feldman Building), 14-19 novembre 2010. Intervention : “Richard Pococke, or the Invention of a Jerusalem for Tourists.” http://www.ef.huji.ac.il/events/Visual%20Constructs%20of%20Jerusalem%20-%20Tentative%20Program,.pdf
9. Architectures pour la guerre et pour la paix : l’humanisme civil et militaire dans l’Europe du XVIe au XVIIIe siècle : Colloque international, 3-4 décembre 2010 , INHA. Organisation en collaboration entre INHA (Emilie d’Orgeix) et le Centre André Chastel. Intervention : « L’architecture en temps de guerre dans l’Histoire naturelle de Pline : la colonne comme trophée. »
10. Art. Création. Cognition : Séminaire, Département d’Histoire et théorie des arts et de philosophie ENS, Département d’histoire de l’art, Paris Ouest Nanterre-La Défense. 15 décembre 2010, ENS, 45, rue d’Ulm, « Les « icônes posées debout » ou l’invention de l’iconostase dans la Russie au XIVe et XVe siècles. » http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=cycles&idcycle=63
– 2010-1011 :
Séminaire de 12 heures, « Entre l’Orient et l’Occident : l’invention de l’art médiéval en Russie au XIXe et au début du XXe siècle », EHESS, CERCEC. http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2010/ue/362/
– 2011 :
1. “Richard Pococke and the Christian East”, Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Seminar Eastern Christianity, 8 avril 2011.
2. « Bouslaev en Europe : lieux, rencontres, discussions, influences », Lieux de production- Lieux de diffusion – Lieux de décision. Journée d’études internationale, 20-21 Mai 2011 : organisée par le Centre d’Études des Mondes Russe, Caucasien, Centre-asiatique et Centre-Européen (CERCEC, EHESS/CNRS) dans le cadre du projet ANR « La constitution des sciences humaines et sociales en Russie : réseaux et circulation des modèles de savoir, du XVIIIe siècle aux années 1920 : Le 21 mai 2011 : École Normale Supérieure.
3. « Les icônes en Russie du XIe au XVIIe siècle », 27 mai 2011 : Préparation aux concours des conservateurs du patrimoine. Université de Paris IV – Université de Paris I – Université de Paris X. INHA, salle Perrot. 18 h – 20 h.
4. « Le théâtre de Scribonius Curion : folie ou prodige ? », Conférence, le 29 mai 2011, 13-14 h., Fontainebleau, Festival d’Histoire de l’art, 1re édition.
5. « Le livre et l’architecte » : Table ronde consacrée à la parution de l’ouvrage, coédition Mardaga-INHA, 14 juin 2011, INHA.
6. « Le Kremlin de Moscou », 27 juillet 2011 : émission dans « Monumental » à la Radio Suisse Romande. http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/monumental/3239762-monumental-du-27-07-2011.html
7. « L’incendie à l’origine de la Cité : autour de Vitruve (II, 1-2) », congrès international : Fuori dall’ordinario : la città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali ; V Congresso dell’Associazione italiana di storia urbana (AISU) ; Roma, 8-9-10 settembre 2011 ; Facoltà di Economia “Federico Caffè”, Università di Roma Tre – Via Silvio D’Amico, 77 – Roma.
8. « La prima edizione di Vignola in Russia », III Corso internazionale di studi sul Vignola, 17 septembre 2011, « Vignola e l’Europa », Centro Internazionale di studi “Jacopo Rarozzi da Vignola”, “Sapienza” Università di Roma e Accademia di San Luca.
9. « Les dessins de Jean-Baptiste Alexandre Le Blond », French Architectural Drawings in the Nationalmuseum, Stockholm ; workshop organisé par Martin Olin et Linnéa Rollenhagen Tilly, 26-28 octobre 2011.
10. « Les arts et les sciences de l’Europe dans la bibliothèque de Pierre le Grand », INHA : Les Actualités de la recherche du jeudi, 2 novembre 2011, salle Giorgio Vasari de 10h.00 à 12h.30.
11. « Les icônes en Russie », EHESS, séminaire commun du master en histoire et civilisation (CERCEC), 14 novembre 2011, 11-13h.
12. « Entre Saint-Pétersbourg et Vicence : le « cas » de Georges Loukomsky », Les enjeux historiques et épistémologiques de l’histoire de l’art de la Renaissance dans la Russie du XXe siècle, journée d’étude organisée par Pierre Caye (Savoirs artistiques et Traités d’Art de la Renaissance aux Lumières (GDRI STAR)), Université Paris-Sorbonne (Paris IV), 19 Novembre 2011.
13. « Scamozzi en français : histoire d’un échec », Traduire l’architecture, journée d’études organisée par Jean-Sébastien Cluzel, Robert Carvais, Juliette Hernu-Bélaud, Valérie Nègre / INHA-CNAM, Paris, INHA, 14-15 décembre 2011. http://blog.apahau.org/journees-detudes-traduire-larchitecture/
– 2011-2012 :
Séminaire de 12 heures, « Entre l’Orient et l’Occident : l’invention de l’art médiéval en Russie au XIXe et au début du XXe siècle », EHESS, CERCEC. http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/ue/226/
– 2012 :
1. « Les icônes en Russie du XIe au XVIIe siècle », cours de préparation aux concours des conservateurs du patrimoine. Université de Paris IV – Université de Paris I – Université de Paris X. INHA, salle Perrot. 20 janvier 2012, 18 h – 20 h
2. « La Russie et l’Europe au XVIIIe siècle », cours de préparation aux concours des conservateurs du patrimoine. Université de Paris IV – Université de Paris I – Université de Paris X. INHA, 27 janvier 2012, salle Perrot. 18 h – 20 h
3. « Les arts et les sciences de l’Europe dans la bibliothèque de Pierre le Grand », contribution aux : Rencontres du Centre André Chastel, 16 mars 2012, 15-16 h. http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/news/les-arts-et-les-sciences-de-leurope-dans-la-bibliotheque-de-pierre-le-grand
4. « Claude Perrault, Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des animaux », intervention de 2 heures dans le cadre du séminaire THETA/CNRS, organisé par Daniel Dauvois, 31 mars 2012, Sorbonne, salle de la rue Serpente. http://theta.vjf.cnrs.fr/
5. « Jean-Baptiste-Michel Vallin de la Mothe (1729-1800) : a ‘Great French Architect in Russia’ ? », contribution à : EAHN, Second International Meeting, Bruxelles, 31/05-03/06 2012.
6. « La découverte de l’art russe médiéval au XIXe siècle », EHESS, séminaire commun du CERCEC, 17 décembre 2012, 2 heures.
– 2013 :
1. « Traduire l’architecture », journée d’étude, INHA, 17/01/2013, présidente de séance.
2. « Les sciences et les arts de l’Europe dans la Bibliothèque de Pierre le Grand », contribution avec Wladimir Berelowitch, dans le cadre du colloque international : Pierre le Grand et l’Europe des sciences et des arts : circulations, réseaux, transferts, métissages, fondation Singer-Polignac, Université Paris VII, 28/03/2013-30/03/2013.
3. « Bâtir sur les ruines », contribution dans le cadre d’une journée d’étude internationale : Ville en ruine : images, mémoires, métamorphoses, Musée du Louvre, 08/04/2013-09/04/2013.
4. « La création de l’académie des beaux-arts à Saint-Pétersbourg au milieu u XVIIIe siècle : enjeux politiques et institutionnelles », contribution au colloque international Le Virtuose Adunanze. La cultura accademica tra XVIe e XVIIIe secolo, Sapienza, Universita de Roma – EPHE, Paris, Sperlonga, commune di Lazio, 09/05/2013-10/05/2013.
5. « Du Manuel au Podlennik : fortune et traduction russe d’un ouvrage d’Adolph Didron », contribution au colloque international Les sciences humaines et sociales en Russie : Invention de langages scientifiques et traduction, CERCEC (EHESS/CNRS) – Laboratoire Pays germaniques (ENS, CNRS), 24/05/2013-25/05/2013.
6. Participation à la table ronde autour de l’ouvrage « Bâtir au féminin », dans le cadre du Festival d’histoire de l’art à Fontainebleau, 01/06/2013.
7. « Bâtir sur les ruines : les thermes des Romaines à Saint-Pétersbourg », contribution au colloque international : Villes en ruines : images, mémoires, métamorphoses, Musée du Louvre, 18/10/2013-19/10/2013.
8. « Entre Palais et Musée : Maximilian Mesmacher et la renaissance de la Renaissance à Saint-Pétersbourg », L’Architecture de la Renaissance au XIXe siècle.” EPHE : séminaire M1-M2, doctorat, sous la coordination d’Antonio Brucculeri et Sabine Frommel, 17/05/2013, 2 h.
9. « Les artistes européens à Saint-Pétersbourg au XVIIIe siècle », Université de Genève, 2 h., séminaire M1-M2, doctorat, 29/05/2013.
10. « Bouslaev, premier historien de l’art russe, entre France et Allemagne », SEMINAIRE TRANSFERTS CULTURELS ; Département d’histoire de l’ENS ; UMR 8547 Pays germaniques-Transferts culturels, séminaire M1-M2, doctorat, sous la direction de Michel Espagne, 2 h.
11. « Le jardin architecturé : Jean-Baptiste Alexandre Le Blond et l’héritage de Le Nôtre », Institut européen des jardins et paysages, 28/09/2013.
12. « Iconostase : sa genèse et son histoire en Russie », dans le cadre du séminaire de Master 1 et 2 et de doctorat, de Wladimir Berelowitch (EHESS-CERCEC), 02/12/2013.
– 2014 :
1. « La circulation des savoirs comme facteur d’européanisation », L’européanisation comme objet et catégorie d’analyse dans les sciences historiques et sociales, Deutsches Historisches Institut, Paris, 8 rue du Parc-Royal, 75003 Paris, en coopération avec « Saisir l’Europe », le CIERA et le LABEX « Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe », 10-11 avril 2014 : www.dhi-paris.fr
2. Festival de Fontainebleau. Organisation et animation de la table ronde autour de l’ouvrage : O. Medvedkova, E. d’Orgeix ed., « Architectures de guerre et de paix » en présence de Laurence Bertrand-Dorléac. 31 mai 2014, 12 – 13.30, château de Fontainebleau, salon des Fleurs. http://festivaldelhistoiredelart.co…
3. « Le thème de la continuité entre l’art gréco-romain et l’art byzantin et russe dans les travaux de Fedor Buslaev, Nikodim Kondakov et André Grabar », La Russie et l’Antiquité. Réception de l’art gréco-romain en Russie. Journée d’étude franco-russe. 17 octobre 2014. Sous la direction de Nadia Podsemskaia. CRAL EHESS, centre Jean-Pépin, CNRS, Université de Paris-Sorbonne. http://cral.ehess.fr/index.php?1723
4. « Le Commentaire au De re aedificatoria de V.P. Zubov (1935-1937) », Le De re aedificatoria. Edition critique, traductions, commentaire. Séminaire international Leon Battista Alberti, sous la direction de Francesco Furlan, THETA, centre Jean Pépin, EHESS, 3-4 novembre 2014. http://www.histoireconstruction.fr/…
5. Participation à la table ronde / présentation de l’ouvrage : Gravures d’architecture et d’ornement au début de l’époque moderne : processus de migration en Europe, Campisano Editore, Roma, 2014. Académie d’Architecture, 13 novembre 2014, 9 place des Vosges, 75004, Paris. http://www.lubliniana-asso.eu/livre…
6. « L’art russe médiéval et sa redécouverte au XIXe siècle », séminaire Formation à l’histoire des mondes russes : l’Ancien Régime : Séminaire de tronc commun (parcours de spécialisation au sein du master Sciences sociales de l’EHESS et de la mention Histoire) entrant dans la formation “Histoire des mondes russe, caucasien, centrasiatique et centre-européen” Responsable : Wladimir Berelowitch (CERCEC) : EHESS, 105 boulevard Raspail, salle 6, 11 h – 13 h. http://www.ehess.fr/fr/enseignement…
7. « Les Edifices antiques de Rome ou les « Edifices antiques de Desgodets » : le livre d’architecture comme modèle d’appropriation », Les nouveaux savoirs de l’architecture moderne. Antoine Desgodets, entre théorie et pratique, colloque international, sous la direction de Robert Carvais, INHA, 24-25 novembre 2014. http://www.inha.fr/fr/agenda/parcou…
8. « Autour du Salon 2 : catalogue comme manifeste », La philosophie dans l’art ? Wassily Kandinsky : questions de transferts, journée d’étude internationale, sous la direction de Jean-Philippe Jaccard et Ioulia Podoroga, Université de Genève, Faculté des Lettres, Uni Bastions, salle B111, 4 décembre 2014. http://www.unige.ch/presse/static/2…
9. Rencontre autour du livre d’Olga Medvedkova « Kandinsky ou la critique des critiques/ Les écrits russes de Kandinsky ». Entretien avec l’auteur mené par Ioulia Podoroga (Philosophe, chercheuse à l’Université de Genève), 5 décembre 2014, 18-19 h. Librairie Le Rameau d’Or, 17, bv Georges-Favon, Genève. http://www.unige.ch/communication/a…
– 2015 :
1. « Les « ornements propres » dans la théorie architecturale française de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle », conférence dans le cadre du séminaire de recherche « L’Ornement », sous la direction de Pierre Caye et Francesco Solinas, Collège de France, 27 mars.
2. « Les Européens : ces architectes qui ont conçu l’Europe (1450-1950) », colloque international, organisé avec le soutien du LabEx EHNE (Université Paris-Sorbonne), du Centre André Chastel (CNRS, Université Paris-Sorbonne) et du Centre Jean Pépin, THETA (CNRS-ENS, Paris), 23-25 avril, direction scientifique du colloque et conférence d’introduction, « Les Vitae des architectes migrants et la notion de l’Europe architecturale ».
Participation aux projets collectifs
– ANR : Desgodets, sous la responsabilité scientifique de Robert Carvais : ANR-07-CORP-017-01 ; référence rapport R01 ; Université de Panthéon-Assas Paris 2 ; période d’activité : 28/12/2007 – 27/12/2011.
– ANR : La constitution des sciences humaines et sociales en Russie : réseaux et circulation des modèles de savoirs, du XVIIIe siècle aux années 1920, sous la responsabilité scientifique de Wladimir Berelowitch, EHESS, Paris, 2010- 2014.
– LabEx : Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe. Membre du comité de pilotage de l’axe 7. Direction du projet de recherche collective, de colloque internationale (23-25 avril 2015) et de publication : « Ces architectes qui ont conçu l’Europe » : 2013-2018. http://www.centrechastel.paris-sorb… http://arteurope.hypotheses.org/
Traductions SHS
– 2009 :
1. Inga Lander, « Les bibliothèques d’architectes en Russie au XVIIIe siècle et au début du XIXe », Bibliothèques d’architecture : architectural libraries, ouvrage collectif sous la direction d’Olga Medvedkova, Paris, INHA-Alain Baudry éditeur, 2009, p. 73-82.
2. Dimitri Ozerkov, « La bibliothèque architecturale de Catherine II », Bibliothèques d’architecture : architectural libraries, ouvrage collectif sous la direction d’Olga Medvedkova, Paris, INHA-Alain Baudry éditeur, 2009, p. 183-210.
3. Hillel (Grégoire) Kazovsky, « ‘C’était l’époque où on a commencé à illustrer des petits livres juifs’ : la littérature, l’art et l’édition juifs dans la création du nouveau livre juif illustré », Futur antérieur : L’avant-garde et le livreyiddish 1914-1939, catalogue de l’exposition au musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 11 février – 17 mai 2009, sous la direction de Nathalie Hazan-Brunet et Hillel Kazovsky, Paris, Couleur, 2009.
4. Abram Efros, « La lampe d’Alladin », Futur antérieur : L’avant-garde et le livreyiddish 1914-1939, catalogue de l’exposition au musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 11 février – 17 mai 2009, sous la direction de Nathalie Hazan-Brunet et Hillel Kazovsky, Paris, Couleur, 2009.
5. Mihail M. Krom, « Etat et réformes en Russie », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 64e année, n° 3, mai-juin 2009, p. p. 561-579.
– 2010 :
1. O. Fadeeva, « Les univers ruraux dans la Russie post-soviétiques », Gilles Favarel-Garrigues, Kathy Rousselet (éd.), La Russie contemporaine, Paris, Fayard, 2010, p. 265-280.
– 2013 :
1. Irina Khmelevskikh, « Une édition en temps de guerre : le Livre de Mars de Pierre le Grand », Architectures de guerre et de paix : du modèle militaire antique à l’architecture civile moderne, ouvrage collectif sous la direction d’Olga Medvedkova et d’Emilie d’Orgeix, Mardaga, Bruxelles, 2013, p. 101-113.
– 2015 :
1. Irina Khmelevskikh, « Introduction au présent catalogue », ainsi qu’une partie du catalogue raisonné de la bibliothèque de Pierre le Grand, Pierre le Grand et ses livres : les arts et les sciences de l’Europe dans la bibliothèque du tsar, ouvrage collectif sous la direction d’Olga Medvedkova, Alain Baudry éditeur, à paraître en 2015, dans la collection « République européenne des lettres » dirigée par Marc Fumaroli et Antoine Compagnon et avec le concours du LABEX « Transferts », sous la direction de Michel Espagne.